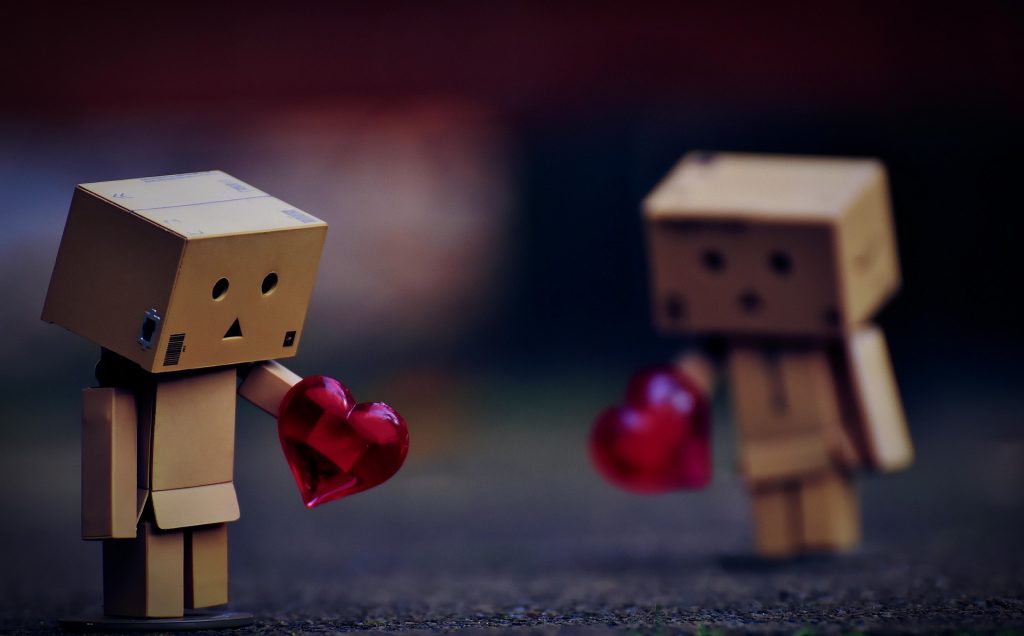[Le vide ]
Toute notre vie tourne autour de la question du vide.
Qui suis-je ? Presque rien ! Et, il en est de même pour les planètes, les ordinateurs ou les légumes. Car toute chose, vivante ou inerte, présente sur Terre ou dans l’espace, est constituée d’atomes. Les atomes, sont constitués de vide à pratiquement 100%. L’être humain est donc constitué de vide à 99,9999 %.
Ce vide est un reste appelé le « manque-à-être », désignant le vide fondamental dans la structure du sujet. Le vide est présent en chacun de nous, et nous essayons de le combler du mieux possible, mais pas toujours de la meilleure des manières. Par exemple, les personnes ayant des troubles alimentaires, sont celles qui, dans certains cas, peuvent vouloir remplir ce vide (boulimie) parce qu’elles pensent que le combler va les rassurer, les apaiser. Cette compensation se fait en faisant le vide autour d’eux ou en eux (régurgitation), comme une manière d’évacuer le trop plein.
L’anorexie de son côté, fonctionne de façon inverse, outre l’idée de refuser sa féminité par l’apparition des formes (dans le cas d’un sujet féminin), donc de grandir, il y a cette contre-phobie du vide, entrainant bien souvent un vacillement entre boulimie-anorexie qui correspond à une phobie, contre-phobie du vide. Un trop gros contrôle de son corps/de soi entraine un clivage psychique; étant donné qu’il y a un équilibre pour chaque chose. Sans contrôle, un risque de décompensation est possible. Obturer un chakra, en l’occurrence le chakra du plexus solaire, empêche l’harmonie de notre système énergétique, entrainant sur le long terme la formation d’un trou énergétique à un tout autre endroit, provoquant une disharmonie.
Quand nous nous considérons comme des coquilles vides, minces, creuses, nous cherchons sans arrêt à remplir ce vide en incorporant/ingérant des objets externes significatifs. Et c’est dans cet espace vide que se ruent des motions pulsionnelles brutes ou à peine élaborées, laissant place à l’irrationalité.
Mais le vide, ce vide dans notre vie, serait-il l’absence ? Ou plutôt ce qui échoit à une absence dont l’objet se serait retiré. Une absence sans absent dirions nous, ou plus encore une absence semblable à une enveloppe vide. En deux mots : une absence hors le temps, sans frontière. Cette absence du vide, n’entrainerait-elle donc pas une dépendance ? Une dépendance à cette absence du vide ?
Ce vide stipule implicitement que la recherche active du vide trahit la compulsion à répéter le non-être d’une rupture primitive dans la continuité d’exister, véritable traumatisme psychique. “Pas de mot pour décrire ce vide intérieur qui aspire ma vie”.
Ainsi, la destructivité est présente chez le sujet qui enrage de se voir si faible, si dépendant d’un objet qui ne répond pas à ses attentes. Dépendant de cet objet qu’il ne maitrise pas, qu’il n’arrive pas à verbaliser, dont il n’arrive pas à échapper. Il s’impute alors une telle faute qu’elle touche son être-même, d’où les effets délétères sur le narcissisme auxquels s’ajoute l’identification à la mort de la mère ou au vide de la mère.
Mais, pourquoi tout se rapporte à la mère ? Car la clinique du vide ou la clinique du négatif est le résultat d’un désinvestissement massif, radical et temporaire de l’objet primaire, qui n’est rien d’autre que la mère. La perte d’amour est un traumatisme narcissique et la désillusion brutale est une perte de sens, que l’enfant attribue à ses pulsions envers l’objet ou à son investissement du tiers, ce qui est encore plus désastreux sur le plan des investissements libidinaux. Ainsi, l’enfant, devant son impuissance à réparer la relation avec la mère et devant l’inefficacité des signes d’appel que sont les cauchemars, etc. (moment où il veut se retrouver seul avec sa mère), le Moi utilise d’autres défenses pour lutter contre l’angoisse. La première est le désinvestissement de l’objet maternel, qui est un véritable meurtre psychique de l’objet et, en même temps, l’identification à la mère morte. Si l’enfant n’intéresse plus la mère, à la fois elle devient sans intérêt et à la fois il SE vit comme sans intérêt.
De ce fait, la perte du sens, de sens, déclenche une régression à des positions/aux stades anal(e)s , c’est-à-dire à des désirs de maîtrise et de vengeance, ainsi qu’une réticence à aimer, une prédilection pour l’auto-érotisme, et une dissociation entre le corps et la psyché. La maitrise sphinctérienne permet de frustrer la mère, qui s’inquiète pour son enfant. Ainsi l’omnipotence de l’enfant prend place, comblant ce vide par le contrôle sur la mère. Les anorexiques et boulimiques sont dans un système où leurs troubles entrainent des complications. Ils s’infligent les répercussions de ces complications ; se prouvant qu’ils ont toujours l’omnipotence, mais qui n’est plus à l’encontre de la mère (morte), car n’ayant pas la maitrise sur ce contrôle, signe désarmant pour elle, cela l’oblige à continuer ainsi jusqu’à ce qu’une solution apparaisse. De ce fait, le sujet, habité par la mère morte, redoute de s’impliquer profondément dans les relations objectales (qui se produisent malgré lui) et toute déception, quasiment inévitable de ce fait, se traduit par la résurgence de la douleur psychique et aussi par l’impossibilité d’introjection d’un quelconque “bon objet” pour remplacer celui qu’une relation affective satisfaisante avec la mère aurait dû constituer.
Mais alors, tout vide provient-il nécessairement de la mère ? Cette dépendance à cette absence de vide, comblée par la mère dans notre enfance, mais aussi cette dépendance à la mère ne doit être présente qu’un temps. Une mère répondant trop à la dépendance de l’enfant, ne permet pas à la mère morte d’emporter, dans le désinvestissement dont elle avait été l’objet, l’essentiel de l’amour dont elle avait investie avant le deuil de son enfant : son regard, le ton de sa voix, son odeur, le souvenir de sa caresse.
Comme Green le souligne, « Il y a alors un enkystement de l’objet et effacement de sa trace par désinvestissement, il y a eu identification primaire à la mère morte et transformation de l’identification positive en identification négative, c’est-à-dire identification au trou laissé par le désinvestissement et non à l’objet”.
L’objet “vide” mène au vide d’objet ; vide qui permet de comprendre pourquoi la solitude est tellement désarçonnante et malgré tout recherchée.
L’enfant doit alors faire son oedipe, afin de sortir de cette dépendance d’avec la mère. Lorsque l’enfant entre dans le complexe d’Oedipe, il est mis dans l’obligation de renoncer à l’objet, d’ accepter qu’il n’est pas tout pour sa mère, ce qui suppose qu’il ait reçu de réelles satisfactions.
Chez les personnes anorexiques et boulimiques, le deuil de la mère n’est pas fait, n’ayant pas procédé de la sorte. Ainsi, non seulement il y a ce désir inconscient de rester enfant, afin d’être soutenue par la mère, la seule capable de combler ce vide. Mais, par ce « jeu de rôle » du passage d’un cycle à l’autre, de cette volonté de créer un trop plein ou un trop vide, est tributaire du rôle de la mère. Dans le complexe de la mère morte, le deuil est impossible, la perte inélaborable. Comme l’indique Mahler “nous assistons à l’échec de l’expérience de séparation individuante où le jeune Moi, au lieu de constituer le réceptacle des investissements postérieurs à la séparation, s’acharne à retenir l’objet primaire et revit répétitivement sa perte, ce qui entraîne au niveau du moi primaire confondu avec l’objet, le sentiment d’une déplétion narcissique se traduisant phénoménologiquement par le sentiment de vide, si caractéristique de la dépression, qui est toujours le résultat d’une blessure narcissique avec déperdition libidinale”. Cette perte narcissique perturbe le dépassement de la position dépressive.
Cette angoisse du vide, est aussi présente par exemple chez les personnes suppliciant leur peau. La peau représente d’abord les limites du corps, soit entre l’interne et l’externe. Se situant donc entre le dedans et le dehors, le « Moi-peau » (Anzieu) est ce qui fonde la relation contenant/contenu.
La peau est aussi le morceau de chair qui relie l’enfant à sa mère, et dans le fantasme de l’enfant c’est une « peau commune » qui les unit. L’angoisse d’être arraché à la mère et déchiré de cette peau est notée par D. Anzieu comme » l’origine à la fois de blessures et du masochisme ».
Le vide est comme il a été indiqué plus haut, hors du temps et sans frontière. La peau représentant les bords entre l’interne et l’externe, une défaillance précoce aboutit à des frontières floues voire inexistantes « entre le Moi psychique et le Moi corporel, entre le Moi réalité et le Moi idéal, ce dépend de soi et de ce qui dépend d’autrui » (Anzieu).
Lorsque la constitution du « Moi-Peau » est défaillante (c’est-à-dire lorsque l’enfant n’arrive pas à différencier la couche externe [faisant écran aux stimulations extérieures], de la couche interne [contient les processus psychiques, le monde intérieur des pensées, des images, des affects]. Ou plus exactement lorsque l’on n’arrive pas à différencier le Moi corporel du Moi psychique. Nous cherchons à instaurer cette frontière, à trouver une frontière à ce vide, puis à la réduire, pour pouvoir le faire disparaitre) son inscription se fait alors en négatif, dans un « attachement au négatif » emprunt de destructivité. L’auto-effacement pulsionnel fait suite à l’attachement empli d’autodestruction, provoquant un artifice d’attachement, préférable à l’indifférence de la mère, conduisant à un vide identificatoire, laissant un trou dans l’être.
Le vide identitaire et identificatoire, se manifeste selon de multiples configurations mais trouve toujours sa source là où quelque chose n’a pas eu (de) lieu.
« L’impensable fait le pensé. Ce qui n’a pas été vécu, éprouvé, ce qui échappe à toute possibilité de mémorisation est au creux de l’être. Ce blanc, répétons- le, n’est pas le simple blanc du discours, le gommé, l’effacé de la censure, le latent du manifeste. Il est, dans sa présence-absence, témoin d’un non-vécu.» Pontalis
Toute notre vie repose sur cette question d’équilibre, entre le plein et le vide.
« Vide ton esprit de toi même »